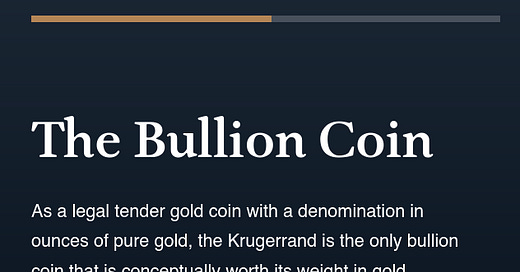Harpagon et ses dix mille écus d’or fait partie d’une longue lignée d’épargnants ayant thésaurisé l’or sous la forme de monnaies. La Grande Guerre a sonné le glas de l’utilisation de l’or dans les moyens de paiement courants et la disparition d’une part significative du stock de ces monnaies, soit thésaurisées soit exportées pour solder des engagements vis-à-vis des États-Unis.
Les tentatives de réintroduire la monnaie d’or dans les transactions entre les deux conflits mondiaux ont peu contribué à apporter la liquidité attendue pour l’épargne. La IIe Guerre mondiale ayant encore accru l’érosion du stock de monnaies d’or, la « petite » épargne en or a dû faire face à une disette de pièces en or, alors constituées uniquement des monnaies internationales démonétisées. Ceci eut pour conséquence de faire flamber la prime des pièces par rapport au lingot de référence de un kilogramme.
Des marchés à sec d’or
Pour pallier cette situation, plusieurs gouvernements ont entrepris d’apporter de la liquidité sur les marchés de l’or en introduisant de nouvelles pièces sous la forme de jetons reproduisant les effigies de monnaies démonétisées. Cette approche présentait deux avantages. D’abord pratique, puisque les flans de ces pièces démonétisées existant déjà il était aisé et rapide de répondre ainsi à la demande. Enfin, la mise sur le marché de pièces portant des effigies auxquelles les thésauriseurs étaient habitués était, d’un point de vue psychologique, un réel atout pour le succès de l’opération. Il faut comprendre que cette époque a connu un réel bouleversement dans le rapport de l’individu à l’argent et donc aux métaux précieux.
États-Unis
Aux États-Unis les épargnants en or ont été à la diète pendant plusieurs décennies. La détention d’or était interdite en 1933 par décret présidentiel, y compris pour les banques et les établissements de la Réserve Fédérale. Cette interdiction ne sera levée que le 31 décembre 1974 par le président Gerald Ford.
L’Autriche ouvre la voie
Après la Grande Guerre l’Autriche, comme tous les pays, avait démonétisé toutes ses monnaies d’or, couronnes autrichiennes, ducats et florins. L’Autriche a un passé prestigieux en matière de numismatique. La nostalgie aidant, l’Autriche avait pratiqué dans les années 1920 des frappes de copies de monnaies démonétisées.
Vers les années 1960, sous la pression des associations numismatiques le gouvernement américain faisait quelques concessions sur l’interdiction de détention d’or, accordant la détention et l’importation pour les monnaies considérées comme relevant de la collection.
Cette décision était opportunément exploitée par l’Autriche qui commercialisât des copies de couronnes, de florins et de ducats or avec des millésimes postérieurs à la démonétisation des modèlesi. La qualité des copies et la beauté de celles-ci ont probablement participé à éblouir les douaniers américains qui les ont considérées comme leurs modèles pour le plus grand bonheur des collectionneurs ou prétendument collectionneurs.
Mexique
Le Mexique a également profité de cette petite ouverture. Alors que ses cinq millions de monnaies d’or de 50 pesos émises depuis 1921 étaient démonétisées en 1931, le pays a commercialisé, de 1943 à 1947, près de 3 600 000 jetons copiant les effigies de la 50 pesos démonétisée pour pourvoir aux besoins du marché. La production de jetons a repris ensuite en 1949 et s’est poursuivie chaque année jusqu’à aujourd’hui. Les 10 millions de jetons commercialisés depuis 1949 affichent tous le même millésime 1947 destiné à les différencier des modèles démonétisés en 1931. Dans les années 1960 le Mexique était donc sur le rang pour fournir le marché américain tout proche qui venait de s’entrouvrir pour les produits de collection.
Suisse
La Suisse, qui avait émis de 1897 à 1935 environ 20 millions de monnaies de 20 francs Vreneli, toutes démonétisées en 1936, a introduit, de 1945 à 1947, 40 millions de jetons copiant les effigies de cette pièce démonétisée mais en y ajoutant un L pour « Lingot », ou l’année de commercialisation, permettant ainsi de les différencier des modèles démonétisés. L’atelier monétaire suisse précise dans une étude sur la monnaie Vreneli :
« Afin de pouvoir distinguer ces pièces de celles frappées en 1935 et de souligner le caractère de marchandise, le millésime "1935" était précédé de la lettre "L" (Lingot = lingot). En mars 1947, le Conseil fédéral décida de supprimer la post-datation, qui n’était pas sans controverse, et donc de supprimer la lettre "L" devant le millésime. Après l’accord de Washington de 1946, on considérait qu’il était permis de frapper l’or déposé par la Deutsche Reichsbank pendant les années de guerre. Les pièces portaient désormais le millésime correct. La référence à la loi sur la monnaie de 1931 était inscrite en marge "OOOOAD / LEGEM ANNI / MCMXXXIO" (selon la loi de 1931ii). » Source : Swissmint 2008/hk
France
La France devait suivre le mouvement en 1951. En effet de 1951 à 1960 la France introduira sur le marché de l’or de Paris 37 483 500 jetons reprenant les effigies des monnaies de 20 francs germinal Marianne-Coq aux millésimes 1907 à 1914 démonétisées par la loi monétaire de 1928. Le cas de la France est très particulier et se distingue des autres pays par une rigueur monétaire pour le moins contestable s’agissant des choix retenus pour la réalisation de ces jetons. En effet, les copies ne présentent, à première vue, aucun signe permettant de les distinguer de leurs modèles démonétisées aux millésimes 1907 à 1914. En outre, cette copie n’affiche pas le même titre d’or que celui des monnaies d’origine (897 ‰ au lieu de 900 ‰). Néanmoins, le gouvernement les introduira en Bourse, via le Fonds de stabilisation des changes, sans publicité et les acheteurs, ignorant la réalité, les achèteront pour la même valeur que leurs modèles. Vendre un produit en prétendant qu’il a une certaine qualité qu’en fait il n’a pas, a un nom. Ça s’appelle une escroquerieiii.
États-Unis
Aux États-Unis les épargnants en or ont été à la diète pendant plusieurs décennies. La détention d’or était interdite en 1933 par décret présidentieliv, y compris pour les banques et les établissements de la Réserve Fédérale. Cette interdiction ne sera levée que le 31 décembre 1974.
La création des monnaies d’investissement ou « bullion coin »
Ainsi sur la période allant du milieu des années 1930 à 1974, hormis le Souverain britannique, plus aucune monnaie en or n’avait cours légal dans le monde. Toutes étaient retournées à l’état de marchandises.
La première monnaie d’investissement
En 1974, ayant opportunément anticipé l’ouverture du marché américain, l’Afrique du Sud lance la production en masse de sa Krugerrand d’une once d’or (3,2 millions de pièces en 1974, 4 millions en 1975, etc.). La particularité de cette monnaie est de renouer avec l’ancienne tradition des monnaies sans valeur faciale apparente (comme le Souverain britannique). En effet la valeur nominale de ce moyen de paiement légal est équivalente à sa valeur intrinsèque soit au prix de l’once d’or à un instant donné.
1979 : Premier crime contre la monnaie
Si l’Afrique du Sud avait préparé cette ouverture du marché américain depuis 1967 ce ne fut pas le cas des autres pays. Et si l’Afrique du Sud avait pris soin de lier la valeur intrinsèque de la Krugerrand à sa valeur monétaire (nominale), les projets qui vont suivre, un peu partout dans le monde, piétine ce principe.
La monnaie d’or devient un produit commercial
Profitant d’une opportunité commerciale inattendue à sa frontière, le Canada suivait l’exemple sud-africain en 1979 avec une monnaie à cours légal d’une once d’or, la Feuille d’érable. Néanmoins, contrairement à l’approche prudente de l’Afrique du Sud, la Feuille d’érable d’une once affiche une valeur faciale de 50 dollars canadiens, alors même que l’once d’or affichait sur les marchés en 1979 un prix moyen de 359 dollars canadiens.
L’exemple du Canada fut suivi en 1981 par la République populaire de Chine et par les États-Unis du Mexique. Les émissions mexicaines de monnaies d’or et d’argent sont faites depuis cette époque, et encore de nos jours, sur le modèle inauguré, ou plutôt remis au goût du jour, par l’Afrique du Sud, soit une valeur intrinsèque inférieure ou égale à la valeur nominale. La Chine a d’abord pris la même voie en émettant en 1982 des Panda or sans valeur faciale. À partir de 1983 les nouvelles émissions ont toutes été réalisées sur le modèle canadien. Ainsi la monnaie Panda de 500 yuans ou une once d’or était émise en 1985 alors que l’once d’or cotait en Chine 926 yuans. Aujourd’hui ces monnaies de 500 yuans de valeur faciale (et désormais de 30 grammes) sont très recherchées et se négocient au-dessus de 21 000 yuans.
En 1986 les États-Unis renouaient avec la frappe de monnaies d’or avec l’American Gold Eagle (AGE) de 50 dollars. L’objectif initial de cette frappe était de compenser les importations de Krugerrand sud-africains après l’embargo ayant frappé tous les produits venant de ce pays ségrégationniste. Cette nouvelle monnaie américaine est rapidement devenue une référence mondiale en matière d’épargne or. Avec une valeur faciale de 50 dollars pour une once d’or, sa valeur intrinsèque dépassait alors 370 dollars américains.
Retenons de cette partie :
Entre les deux Guerres, tous les pays ont abandonné l’utilisation de la monnaie d’or à cours légal.
Depuis 1979, les émissions de monnaies d’or d’investissement à cours légal se sont multipliées.
Hormis la Krugerrand et la Libertad, toutes les monnaies d’or d’investissement présentent une valeur faciale très inférieure à leur valeur intrinsèque.
i100 et 20 couronnes : 1915, 10 couronnes : 1912, 1 et 4 ducats : 1915, 4 et 8 florins : 1892.
ii« Selon la Loi de 1931 » pour signifier que les pièces copiant les effigies de Vreneli étaient garanties au titre de 900 millièmes d’or conformément à la Loi de 1931, ceci pour pallier l’absence du titre sur les effigies initiales.
iiihttps://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1520
ivUnited States Executive Order 6102 signé par Franklin Roosevelt le 5 avril 1933.