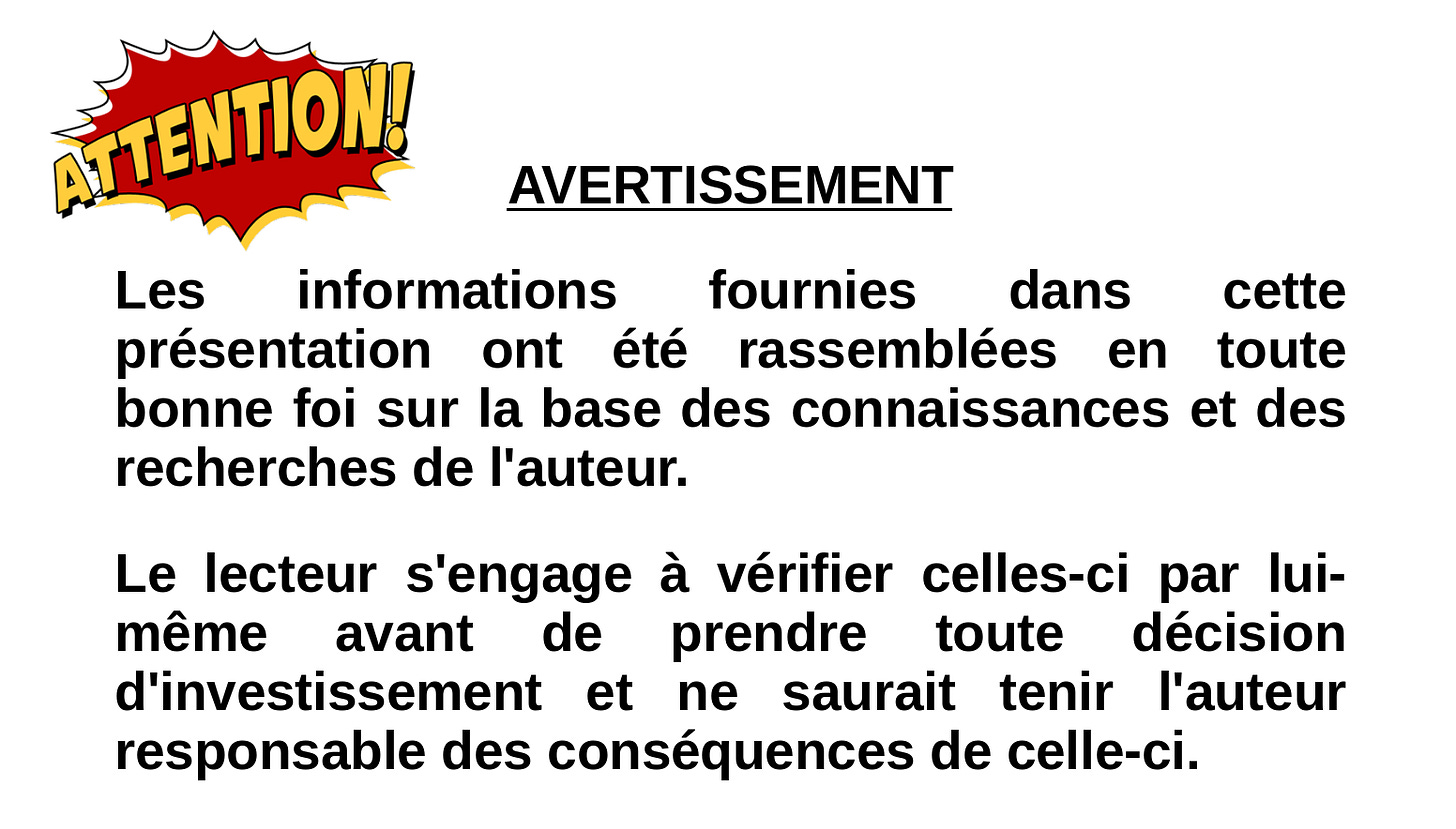En 2012, un vendeur professionnel de métaux précieux suisse, Euporos, s’est adressé à l’administration fiscale française, et plus précisément à la Direction de la législation fiscale (DLF) de Bercy. Autant dire qu’il s’adresse à Dieu le père en matière de connaissance des arcanesi de la fiscalité hexagonale.
La question d’Euporos est simple : les ventes de pièces d’argent, telles que American Silver Eagle, Feuille d’érable et Philharmoniker de 1,5 euroii, qui sont toutes des moyens de paiement légaux, doivent-elles être soumises à la TVA ?
La réponse de la DLF intégralement accessible sur le site d’Euporos vaut que nous nous y attardions même si l’explication de texte vous paraîtra sans doute un peu indigeste.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Dans un premier temps, la DLF relève que l’article 261C du Code général des impôts (CGI article 1. d) exonère de TVA les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux.
Dans sa démonstration la DLF prend néanmoins une liberté vis-à-vis du texte du CGI en parlant ici de « monnaies courantes, qui sont des moyens de paiement légaux ».
L’original de l’article 261C dit simplement que « Les opérations, y compris la négociation, portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux à l’exception des monnaies et billets de collection ; » sans introduire cette subtilité sur les « monnaies courantes », subtilité qui d’ailleurs ne fait l’objet d’aucune définition dans la littérature fiscale officielle.
Il y aurait donc, selon la DLF, des monnaies courantes et des monnaies non-courantes, l’objectif de la DLF étant d’arriver à rattacher à cette notion de « non courantes », les monnaies qui sont dans la question posée par Euporos. Voyons la suite.
Puis l’administration aborde la définition des monnaies de collection, tirée de l’article 256iv (IV- 2- a)du CGI, en glissant entre « leur fonction comme moyen de paiement légal » et « ou qui présentent un intérêt numismatique » le texte suivant de son cru « quand bien même leur qualité fonctionnelle de moyen de paiement est restée intacte ».
Ce simple ajout montre l’embarras dans lequel se trouve l’administration face à ces objets qu’elle a créés, ces monnaies à cours légal dont la valeur faciale est inférieure à leur valeur intrinsèque. Pour la DLF, ces pièces restent néanmoins des moyens de paiement légaux, mais pas tout à fait. Alors pourquoi en conclure que ces pièces « constituent des pièces de collection dont la livraison est soumise à TVA » alors que cette administration admet elle-même que « leur qualité fonctionnelle de moyen de paiement est restée intacte »? Alors moyens de paiement légaux ou objets de collection ?
Dans une note d’information sur la monnaie européenne d’octobre 2015 la Banque de France, abordant le cas des pièces en euros à cours légal, baptisées improprementv de collection, écrit : « Assimilées à des objets de collection, elles sont présentées dans un conditionnement spécifique et accompagnées d’un certificat. N’ayant pas vocation à être utilisées comme moyen de paiement, elles sont généralement acquises pour thésaurisation. Le propriétaire de telles pièces est toutefois autorisé à les échanger à la Banque de France qui assure, au profit des particuliers, un service de reprise à valeur faciale des pièces de collection émises en France, au guichet de sa succursale de Paris (48, boulevard Raspail, Paris 6e). » Si ces monnaies sont reprises à leur valeur faciale c’est donc bien qu’elles sont des moyens de paiement légaux.
À certaines époques, alors que les monnaies en or et en argent étaient les monnaies fiduciaires d’usage, de façon inhabituelle le prix du métal contenu dépassait la valeur faciale. Les détenteurs de ces monnaies les thésaurisaient systématiquement, car il était plus intéressant de les fondre (chose interdite par la loi néanmoins) que de les utiliser comme moyen de paiement. Dès lors les États, craignant que cette situation entraîne un assèchement de liquidités et donc conduise à une crise monétaire, les retiraient de la circulation pour les fondre et émettre ensuite de nouvelles monnaies avec de nouvelles valeurs faciales. Cette situation s’est reproduite plusieurs fois dans l’histoire monétaire de tous les pays dont en France.
Aujourd’hui les monnaies fiduciaires circulantes ont des valeurs intrinsèques très inférieures à leurs valeurs faciales, hormis quelques situations ponctuelles pouvant survenir sur des pièces de très petites valeurs facialesvi à l’occasion de flambées des prix de métaux non-précieux (nickel, cuivre).
Les émissions de moyens de paiement légaux en métaux précieux réalisés de nos jours, à deux exceptions prèsvii, mettent en circulation des monnaies dont la valeur faciale est très inférieure à la valeur intrinsèque. Cette pratique permet de « subventionner » les ateliers monétaires dont les moyens de production sont surdimensionnés depuis la généralisation du numéraire papier et de la dématérialisation monétaire.
Une émission de moyens de paiement, quel que soit le type de moyen de paiement, est de fait une mise en circulation. C’est d’ailleurs ce que la BCE précisait dans son avis du 23 août 2011viii : « La notion d’émission est généralement comprise comme couvrant également la mise en circulation des pièces en euros concernées. »
L’exercice d’équilibre sémantique de la BCE dans ce document est d’ailleurs intéressant. Dans celui-ci la banque précise en outre que les « pièces de collection en euros » sont celles « qui ne sont pas destinées à la circulation. » Comment des pièces pourraient être à la fois mises en circulation et en même temps ne pas être destinées à être mises en circulation ?
La BCE avoue un peu plus loin que « Les États membres ne disposent pas de mesures leur permettant d’empêcher que les pièces de collection en euros soient utilisées comme moyen de paiement. »
En résumé, ces pièces ne sont pas destinées à la circulation, néanmoins, elles circulent ainsi que le reconnaît la BCE, car rien ne permet de l’empêcher.
Qu’il puisse y avoir des personnes cherchant à acquérir pour 20 euros une pièce en argent autrichienne d’une valeur faciale de 1,5 euros ne changent rien au fait que la pièce a servi entre l’acheteur et le vendeur de moyen de paiement. De la même façon lorsqu’une personne cherche à amasser toutes les pièces émises dans la zone Euro et qu’elle est prête à payer 2 euros une pièce finlandaise de 1 euro, ceci ne change rien au fait que cette pièce finlandaise de 1 euro reste un moyen de paiement légal dans l’ensemble de la zone Euro. Le fait qu’un collectionneur porte un regard intéressé sur une pièce à cours légal ne déclenche pas pour autant sa démonétisation.
Enfin, la conclusion de la DLF considérant les moyens de paiement en argent comme des pièces de collection, car « anormales » à ses yeux, la normalité étant pour la DLF que la valeur faciale soit supérieure ou égale à la valeur intrinsèque, est une nouvelle définition propre à la DLF de « monnaie de collection ». Celle-ci va à l’encontre de la définition de la notion d’objet de collection donnée par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans deux arrêtsix prononcés en 1985.
Parmi les critères retenus par la CJUE pour être qualifiés d’objets de collection, ceux-ci doivent être pour le moins rares et leur production arrêtée. Or les pièces, objet de cette question posée à la DLF, sont produites chaque année à des centaines de milliers d’exemplaires lorsque ce n’est pas à plusieurs millionsx d’exemplaires. Le raisonnement de la DLF conduisant à considérer ces monnaies comme des objets de collection ne tient donc pas en face de la définition donnée par la CJUE.
Le plus étonnant est de trouver dans la littérature même de la DLF des éléments infirmant cette même conclusion. Dans sa réponse au vendeur suisse la DLF fait référence à un bulletin officiel des impôts (BOI), en l’occurrence le BOI 3K-2-08 du 10 décembre 2008xi.
Qu’y trouve-t-on ? Tout simplement le rappel des critères arrêtés par la CJUE en 1985 et leur prise en compte désormais dans le droit fiscal français confirmé par ce BOI. Avouez qu’il est tout de même cocasse de voir la DLF prendre une position à l’inverse du BOI qu’elle a elle-même publié et de surcroît y faire référence.
Les mêmes éléments, tirés des arrêts de la CJUE, sont repris dans l’article 70 du BOI-RPPM-PVBMC-20-10 : « À cet égard, la qualification d’objet de collection découle de l’application d’un ou plusieurs des critères suivants : l’ancienneté ; la rareté ; l’importance de son prix, lequel doit être sensiblement supérieur à la valeur d’un bien similaire destiné à un usage courant ; l’arrêt de la fabrication du bien ; la provenance ou la destination ; l’intérêt historique qu’il présente ; le fait qu’il ait appartenu à un personnage célèbre. » La DLF en est, a priori, également l’auteur.
Mais dans ce même dernier BOI, l’article 80 vient clore définitivement tout doute sur la classification en objet de collection de ces pièces. Les termes sont ici clairs et se réfèrent directement à la question posée : « Il est précisé que les monnaies ayant cours légal dans le pays d’émission, même placées dans des présentoirs et destinées à la vente au public, ne constituent pas, au sens de ces dispositions, des objets de collection ; »
Cette précision, sur le maintien de la qualité de moyen de paiement légal des pièces ainsi présentées, a été introduite après la publication de l’Avis de la BCE du 23 août 2011, déjà mentionné plus haut, qui proposait de remplacer la rédaction initiale de l’article 6, paragraphe 5, du règlement proposé par « Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour décourager l’utilisation des pièces de collection en euros comme moyen de paiement, notamment au moyen d’un emballage particulier, d’un certificat d’authentification, d’une annonce préalable de l’autorité émettrice ou d’une vente au-delà de la valeur faciale. »
Si vous m’autorisez une répétition, cette précision va me permettre de terminer en illustrant la cacophonie sémantique qui existe dans ces dispositions fiscales, française et de l’UE.
En effet, la BCE mentionne dans sa proposition de rédaction « pièces de collection en euros comme moyen de paiement », ce qui correspond à des pièces en or ou en argent ayant cours légal selon la définition de l’article 1. 3) du Règlement (UE) No 651/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant l’émission de pièces en euros. Lequel article est un morceau de bravoure sémantiquexii définissant un concept en citant le concept lui-même (circularité) et en en utilisant deux autres, considérés initialement comme synonymes, mais en les opposant ici.
Un chef-d’œuvre de sémantique ! Appréciez :
« 3) « pièces de collection », les pièces de collection en euros qui ne sont pas émises dans le but d’être mises en circulation. »
Dans un premier temps, une « pièce de collection » est une « pièce de collection » ! “Collection” étant ici, à l’évidence, sans rapport avec la définition de la CJUE.
Ensuite, selon l’expertise incontestable de la BCE dans ce domaine, celle-ci affirme, dans le même avis au paragraphe 1.4, que « La notion d’émission est généralement comprise comme couvrant également la mise en circulation des pièces en euros concernées. » Donc si ces pièces sont émises, elles sont considérées avoir été mises en circulation. Qu’il y ait un vœu, ou pas, de ne pas les voir circuler, force est de se résoudre à constater qu’elles circulent.
Donc il faut bien l’écrire à un moment ou à un autre : ce ne sont pas des objets de collection mais bel et bien des moyens de paiement légaux avec toutes les conséquences fiscales qui y sont attachées.
Tordre les mots et les phrases pour arriver à démontrer l’indémontrable n’est pas digne de Dieu. Il est vrai, c’est difficile de reconnaître que l’on s’est trompé quand on est Dieu !
iConnaissances ou informations seulement accessibles à certains initiés, difficiles à comprendre pour le commun des mortels.
iiDans la liste Euporos ajoutait la pièce andoranne de 1 Diner, ce professionnel ignorant que cette pièce n’a aucun cours légal et n’est qu’un jeton folklorique d’Andorre.
ivArticle 256 du CGI :« Sont considérés comme des monnaies et billets de collection, les pièces en or autres que celles visées au 2 de l’article 298 sexdecies A en argent ou autre métal, ainsi que les billets qui ne sont pas normalement utilisés dans leur fonction comme moyen de paiement légal ou qui présentent un intérêt numismatique; »
vImproprement parce que cette appellation « collection », homonyme de « collection » au sens de la seule définition qui fasse foi, celle de la Cour de justice de l’Union européenne, est à l’origine de nombreuses incompréhensions. Pour éviter ces difficultés il aurait fallu que l’article 5 du Règlement (UE) n° 651/2012 concernant l’émission de pièces en euros baptise autrement ces pièces.
viWikipedia : En décembre 2010, le comité permanent du Sénat canadien sur les finances nationales préconise le retrait des pièces de 1 cent du fait de leur relatif haut coût de fabrication par rapport à leur valeur réelle. Une pièce de 1 cent coûte en effet 1,6 cent à produire.
viiHormis la Krugerrand or d’Afrique du sud et les Libertad, or et argent, mexicaines.
viiiAvis de la BCE du 23 août 2011 sur une proposition de règlement concernant l’émission de pièces en euros et sur une proposition de règlement sur les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces libellées en euros destinées à la circulation (CON/2011/65).
ixDans deux arrêts du 10 octobre 1985 (affaire 200-84, Erika Daiber contre Hauptzollamt Reutlingen et affaire 252-84, Collector Guns GmbH & Co contre Hauptzollamt Koblenz), la CJCE précise que les objets pour collections au sens de la position 97.05 du tarif douanier commun sont ceux qui présentent les qualités requises pour être admis au sein d’une collection, c’est-à-dire les objets qui sont relativement rares, ne sont pas normalement utilisés conformément à leur destination initiale (sans pourtant exclure que leurs qualités fonctionnelles puissent rester intactes), font l’objet de transactions spéciales en dehors du commerce habituel des objets similaires utilisables et ont une valeur élevée.
xEn 2016, 37 701 500 exemplaires d’ASE ont été mis en circulation.
xiLe paragraphe A de ce BOI traite de la « DEFINITION COMMUNAUTAIRE DES OBJETS DE COLLECTION, PRECISEE PAR LA JURISPRUDENCE DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES (CJCE) », et le paragraphe B de la « DEFINITION DES OBJETS DE COLLECTION EN DROIT INTERNE ». Ce document est aujourd’hui remplacé par le BOI-TVA-SECT-90-10-20140411.
xiiOu « l’art de la signification ».
Je ne donne aucun conseil mais je répondrais volontiers à vos questions ou vos remarques. L’utilisation de ces informations et leur diffusion sont libres de droit, je vous demande simplement de bien vouloir citer le lien URL de cette page.
Vos commentaires seront bien entendus toujours les bienvenus, que ce soit pour éclaircir une information, pour faire une proposition ou bien encore pour révéler une erreur ou une une coquille.