C'EST ÇA LA JUSTICE ?
Analyse de l’arrêt du Tribunal administratif de Strasbourg, 3ᵉ Chambre du 8 avril 2024
Analyse de l’arrêt du Tribunal administratif de Strasbourg,
3ᵉ Chambre du 8 avril 2024, 2208490
Contexte :
Le contrôle fiscal a mis en évidence la non-perception de la taxe forfaitaire sur les métaux précieux (TMP) pour certaines cessions.
L’acheteur, la SARL Comptoir de l'or, étant responsable vis-à-vis du fisc, le redressement porte principalement sur les taxes et cotisations non collectées.
Le texte complet de l’arrêt est ici.
Textes en italique : extraits de l’arrêt.
Textes non formatés: mon commentaire.
Les arguments de la SARL Comptoir de l'or :
- la taxe sur les métaux précieux est contraire à la première et la sixième directive de taxe sur le chiffre d'affaires.
Cet argument n’a aucun sens. La directive en question porte sur la TVA alors que la « taxe sur les objets précieux » porte sur la taxation des cessions (TMP et taxe sur la plus-value), domaine couvert uniquement par la législation nationale.
- la taxe est contraire au principe général du droit de l'Union européenne de non-discrimination et à la convention fiscale bilatérale de lutte contre les doubles impositions conclue entre la France et l'Allemagne ;
Il y aurait double imposition si un vendeur allemand (par exemple) vendant en France était à la fois redevable d’une taxe en France ET en Allemagne. Or la taxe sur les « objets précieux », dont la TMP, n’est pas due pour les cessions réalisées par des « Contribuables qui n’ont pas en France leur domicile fiscal » (article 340 du BOI-RPPM-PVBMC-20-10 du 31/12/2018).
- le II de l'article 150 VI du Code général des impôts a été déclaré contraire à la Constitution par une décision du 27 novembre 2020 du Conseil constitutionnel qui a considéré qu'il existait une différence de traitement injustifiée entre les contribuables cédant leurs biens selon que ceux-ci sont physiquement situés dans un État de l'Union européenne ou dans un État tiers ; de la même manière, il existe une différence injustifiée du point de vue du collecteur de la taxe, selon que la cession a lieu en France et donne lieu à perception de cette taxe, ou dans un autre pays membre de l'Union européenne dans lequel cette taxe n'est pas réclamée ;
S’agissant des cessions hors de l’UE, les dispositions fiscales du II de l'article 150 VI du Code général des impôts applicables en vigueur jusqu’à leur révocation en 2020, ont été annulées par la Décision n° 2020-868 QPC du Conseil constitutionnel du 27 novembre 2020. Ces dispositions concernaient UNIQUEMENT les obligations des vendeurs d’« objets précieux ». Ceci n’a donc RIEN à voir avec le mécanisme de collecte de la taxe et des cotisations, et en particulier avec les responsabilités de l’acheteur professionnel vis-à-vis de l’administration fiscale.
- la reconstitution de la base imposable de la taxe sur les métaux précieux est erronée, puisque c'est à tort que l'administration fiscale y a inclus les monnaies ayant cours légal dans le pays d'émission et frappées postérieurement à 1800, qui sont pourtant exclues de son champ d'application ;
La Loi n°76-660 du 19 juillet 1976 portant imposition des plus-values et création d’une taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité ne définit pas le concept de « métaux précieux ». De la même façon le Décret n°76-1240 du 29 décembre 1976 est muet sur le sujet. Néanmoins cette définition est donnée très précisément dans la première instruction fiscale ayant suivi l’adoption de la loi. Le paragraphe 367 de l’Instruction 8 M-1-76 n° 239 publiée au Bulletin officiel de la délégation générale des Impôts du 30 décembre 1976 précise ce concept en utilisant la codification du tarif extérieur commun codifiant les marchandises. Dès lors les « métaux précieux » au sens strictement fiscal sont :
« Les métaux précieux sont définis par la législation qui leur est propre. Il s’agit, en pratique, des articles correspondant aux rubriques suivantes du tarif extérieur commun :
• 71-05 Argent et alliages d’argent.
• 71-07 Or et alliage d’or.
• 71-09 Platine et alliages de platine (1).
• 71-11 Cendres d’orfèvre, débris et déchets de métaux précieux (2).
• 72-01 Monnaies d’or et d’argent (à l’exclusion de celles datant d’avant 1800, cf. ci-après n°369) »
Dans cette définition le code utilisé pour les monnaies d’or et d’argent correspond à des monnaies démonétisées. Il n’a donc jamais été question d’inclure dans le champ de la loi de 1976 les monnaies à cours légal.
Les arguments du rapporteur de la cour :
- Toutefois, la base d'imposition de la taxe est uniquement régie par la loi fiscale interne, qui n'institue aucune différence en raison de la nationalité de la personne assujettie à la taxe.
Ceci n’est pas exact. En effet la taxe sur les « objets précieux », et donc la TMP, n’est pas due pour les cessions réalisées par des « contribuables qui n’ont pas en France leur domicile fiscal » tel que précisé par l’article 340 du BOI-RPPM-PVBMC-20-10 du 31/12/2018.
- En troisième lieu, si la société requérante fait valoir que la taxe sur les métaux précieux méconnaît les stipulations de l'article 21 de la convention fiscale bilatérale conclue entre la France et l'Allemagne, selon lequel : " Les nationaux d'un État contractant ne sont soumis dans l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que les impositions et les obligations y relatives auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État se trouvant dans la même situation ", cette taxe, qui n'a pas d'équivalent en Allemagne, n'entre en tout état de cause pas dans le champ d'application de cette convention dont le but est d'éviter les doubles impositions. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
La taxe sur les « objets précieux », dont la TMP, n’est pas due pour les cessions réalisées par des « Contribuables qui n’ont pas en France leur domicile fiscal » (article 340 du BOI-RPPM-PVBMC-20-10 du 31/12/2018). Donc si l’administration a estimé que la SARL Comptoir de l'or aurait dû collecter la TMP sur les cessions réalisées par des personnes fiscalement domiciliées en Allemagne, elle a tort.
- En dernier lieu, en l'absence de disposition contraire, la taxe sur les métaux précieux est applicable aux cessions à titre onéreux d'or d'investissement, défini à l'article 298 sexdecies A du Code général des impôts comme " les pièces d'une pureté égale ou supérieure à 900 millièmes qui ont été frappées après 1800, ont ou ont eu cours légal dans leur pays d'origine et dont le prix de vente n'excède pas de plus de 80 % la valeur de l'or qu'elles contiennent ", dès lors que l'or d'investissement constitue un métal précieux au sens et pour l'application des dispositions de l'article 150 VI du Code général des impôts précité. À cet égard, aucune disposition du Code général des impôts ne permet d'assimiler le régime de la taxe en litige à celui de la taxe sur la valeur ajoutée, et ainsi d'en exonérer les transactions portant sur des monnaies ayant cours légal, ou de considérer que doit leur être appliqué le régime des plus-values de cession de biens mobiliers.
Le rapporteur en redéfinissant le concept de « métaux précieux » en l’assimilant à « or d’investissement », un produit financier (voir BOI-TVA-SECT-30-10) fait là une erreur grossière puisque celle-ci conduit à inclure dans le champ des « métaux précieux », au sens fiscal, les monnaies d’or.
Exemple: un jeton en or d’un titre de 999 millièmes est exonéré de TVA au titre de l’or d’investissement, mais au moment de sa cession est taxé dans la catégorie fiscale des “Bijoux et assimilés” et non dans celle des “métaux précieux” (article 60 du BOI-RPPM-PVBMC-20-10).
Cette erreur est d’autant plus incroyable que le paragraphe suivant (ci-dessous) reprend la bonne définition du concept de « métaux précieux » au sens fiscal, qui ici, en revanche, n’aborde pas la notion de monnaie à cours légal. Une pirouette très ingénieuse pour arriver à démontrer l’indémontrable.
- Pour l'application de dispositions citées au point 2, l'instruction fiscale BOI-RPPM-PVBMC [nota : la bonne référence est avec “-10” en fin] du 1er avril 2014, relative à cette taxe dispose, dans sa version applicable au litige, que : " Les métaux précieux sont définis par la législation qui leur est propre. Il s'agit, en pratique, … - monnaies d'or et d'argent postérieures à 1800. Les autres monnaies d'or et d'argent sont considérées comme des objets de collection / () / Les objets d'or et d'argent travaillés sont classés parmi les bijoux et assimilés, par analogie avec la bijouterie, et ne relèvent donc pas de la catégorie des métaux précieux. Cette règle comporte toutefois une exception : les monnaies d'or et d'argent sont considérées soit comme des métaux précieux lorsqu'elles sont postérieures à 1800 (cf. I-A § 20), soit comme des objets de collection lorsqu'elles sont antérieures à cette date (cf. I-B-3 § 70) / 3. Objets de collection () / Il s'agit notamment des articles suivants : / () / - monnaies d'or et d'argent antérieures à 1800. Il est précisé que les monnaies ayant cours légal dans le pays d'émission, même placées dans des présentoirs et destinées à la vente au public, ne constituent pas, au sens de ces dispositions, des objets de collection ; () ".
Au fil des années, les termes initiaux de l’instruction fiscale de 1976 ont été épurés des précisions données par les auteurs de celle-ci, contemporains de la loi de 1976 (voir ci-dessous un extrait de l’article 369 de l’instruction du 30 décembre 1976) :
En omettant de préciser que l’exception concernait les monnaies d’or et d’argent classées 72-01, soit des monnaies démonétisées, la nouvelle instruction fiscale laisse le lecteur dans le flou conduisant ainsi à cette interprétation erronée par le rapporteur des intentions du législateur de 1976.
Par ailleurs en précisant que « les monnaies ayant cours légal dans le pays d'émission, même placées dans des présentoirs et destinées à la vente au public, ne constituent pas, au sens de ces dispositions, des objets de collection » le rédacteur de l’instruction de 1976 affirmait ainsi que ces monnaies restaient des monnaies à cours légal, et non pas des marchandises codifiées 72-01.
- La requérante oppose au service cette instruction fiscale, qu'elle interprète comme excluant les monnaies d'or ayant cours légal postérieures à l'année 1800 du champ d'application de la taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité. Toutefois, il résulte des termes de cette doctrine que les monnaies d'or et d'argent postérieures à 1800 sont des métaux précieux, qu'elles aient ou non cours légal dans le pays d'émission. Les monnaies d'or et d'argent antérieures à 1800, sauf celles ayant cours légal, sont considérées comme des objets de collection. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, cette instruction fiscale, qui ne comporte pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement, n'exclut pas les monnaies ayant cours légal postérieurement à 1800 de la catégorie des métaux précieux. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service a intégré, dans la base imposable à la taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection ou d'antiquité, le montant des achats des pièces de monnaies ayant cours légal et frappées postérieurement à 1800.
La démonstration du rapporteur s’apparente ici à un véritable tour de bonneteau. Selon celui-ci, la fiscalité des cessions de monnaies d’or se résumerait donc ainsi :
La démonstration du rapporteur, qui évoque confusément une doctrine, mais n’en précise pas l’origine, se termine sans qualifier la catégorie fiscale à laquelle rattacher les éventuelles cessions de monnaies d’or à cours légal émises avant 1800 : « Les monnaies d'or et d'argent antérieures à 1800, sauf celles ayant cours légal, sont considérées comme des objets de collection. ».
Fort heureusement il n’existe plus aucune monnaie, d’or ou d’argent, émise avant 1800 et ayant encore de nos jours cours légal et pouvoir libératoire.
Conclusion :
A défaut d’avoir fait les recherches nécessaires sur les différents textes de 1976 (la loi et l’instruction fiscale), une bonne compréhension des concepts de moyen de paiement légal et d’unité monétaire, abordés en 1ʳᵉ année de droit, aurait permis au rapporteur de confirmer l’exclusion des moyens de paiement légaux, qu’ils soient en or ou en papier, du périmètre des marchandises.
À l’évidence, en 1976 le rédacteur de l’instruction fiscale mettant en œuvre la Loi n°76-660 du 19 juillet 1976 avait cette compréhension. Il est aussi évident qu’en 2024 cette compréhension fait défaut dans les administrations fiscale et judiciaire.
Cet arrêt démontre la pauvreté et l’approximation des démonstrations de la part du rapporteur. Il est regrettable que le juge ait pu faire siennes les conclusions qui lui ont été soumises.
Je ne donne aucun conseil mais je répondrais volontiers à vos questions ou vos remarques. L’utilisation de ces informations et leur diffusion sont libres de droit, je vous demande simplement de bien vouloir citer le lien URL de cette page.
Vos commentaires seront bien entendus toujours les bienvenus, que ce soit pour éclaircir une information, pour faire une proposition ou bien encore pour révéler une erreur ou une une coquille.







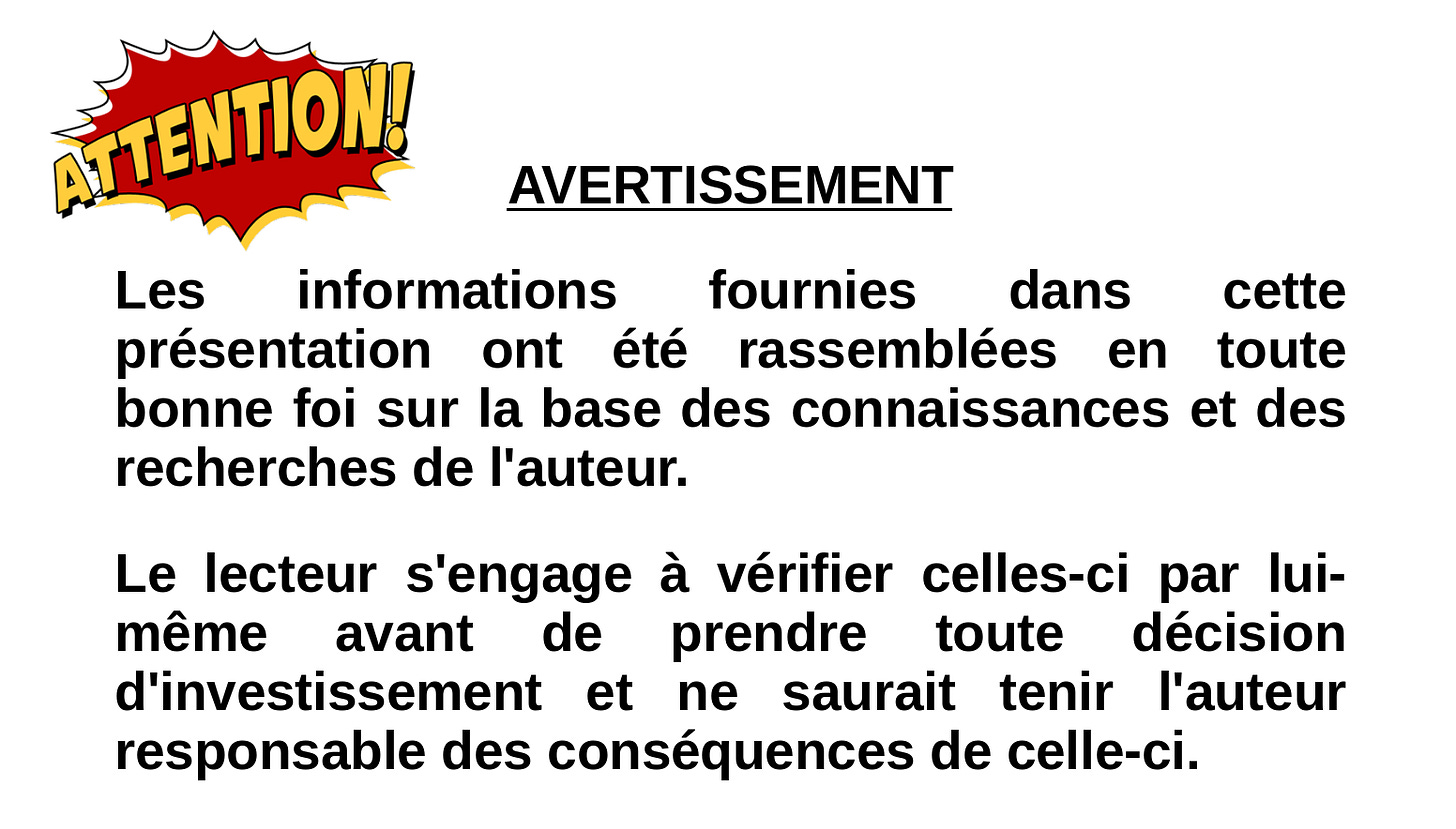
Bonjour Jean-Luc
En effet c'est réellement navrant de voir ça ...
Malheureusement ce n'est pas le seul exemple. C'est terrible de lire des arrêts de ce genre et de se retrouver en face de gens ayant un tel pouvoir mais qui sont incapables d'avoir un raisonnement construit. La justice hérite des hordes d’illettrés que l’Éducation nationale met sur le marché du travail chaque année. Cette situation se retrouve dans toutes les administrations.
Pour la suite je vais essayé d'en savoir plus. A bientôt.
Bonjour Yannick,
La décision de ce Tribunal administratif est effectivement une aberration. Comme elle date d’avril 2024, j’ose espérer que le requérant a fait appel dans le délai légal de deux mois auprès de la Cour d’Appel Administrative (ou directement devant le Conseil d’État ?).
Le parti pris et le manque de culture fiscale du rapporteur (il donne vraiment l’impression d’être en mode « il faut sauver l’Institution fiscale ») sont flagrants. Par contre, je suis étonné et fort déçu de l’indigence intellectuelle du juge qui a crû bon entériner sans barguigner les recommandations du rapporteur.
Si cela vous est possible, pourra-t-on avoir la suite des évènements si, comme je l'espère, le requérant s’est bien pourvu en appel ?
En tout cas, merci Yannick de nous tenir au courant de ces décisions de justice, c’est très important pour nous, simples lecteurs et spectateurs, de nourrir notre culture fiscalo-judiciaire. Merci de laisser vos antennes sorties !